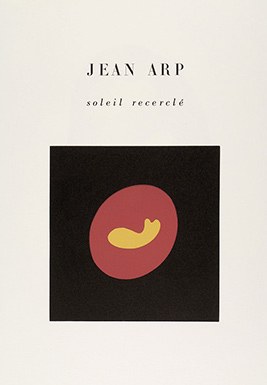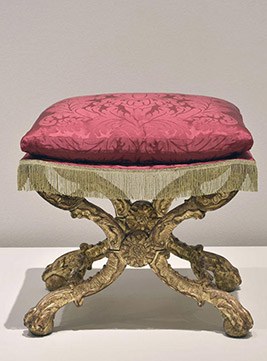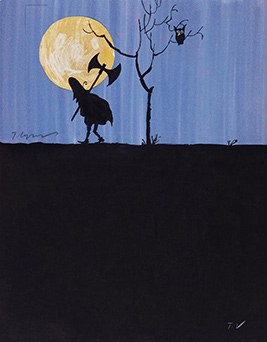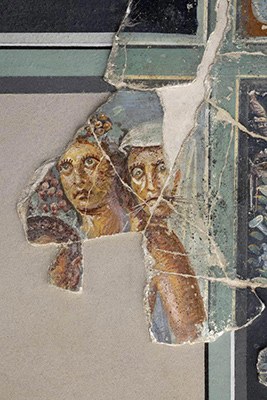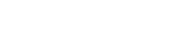Entête de page
Bienvenue dans les musées
QuickLink (Découvrir, En ce moment, Visiter)
Agrégateur de contenus
Agrégateur de contenus
En bref
Fermeture du Musée Historique
Le musée sera fermé du 2 avril au 17 mai 2024 pour travaux.
Fermeture du Musée Tomi Ungerer
Le musée sera fermé du 8 au 24 avril pour montage d'exposition. Rendez-vous le 25 avril dès 10h pour découvrir l'exposition "Julie Doucet. Une rétrospection".
Afficheur d'événements
En ce momentdans les musées
Bannière exposition

Toutes les expositions
En savoir plusAgrégateur de contenus
Agrégateur de contenus
Les collections
Retrouvez toutes les oeuvres des musées de Strasbourg sur le portail dédié
Portail des collections